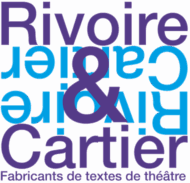Cinq dialogues philosophiques et prosaïques pour 2 à 12 interprètes (durée : 70 à 90 min)
Compatibilité avec votre compagnie
✔️ 2 à 12 comédiens
✔️ Répartition entièrement adaptable (de 1F/1H à 6F/6H)
✔️ Décors très légers (espaces symboliques, bureaux, intérieurs suggérés)
Et vérifiez si cette pièce correspond à votre compagnie.
Résumé de la pièce
Dialogues vagabonds est composé de cinq dialogues autonomes, reliés par une même forme : le face-à-face verbal.
Un auteur confronté à des programmateurs cyniques.
Un homme qui fait de ses chaussettes un projet de vie.
Une consultation psy qui dérive vers une philosophie de la souffrance.
Deux enseignantes au bord de la rupture.
Un·e penseur·se mondial·e confronté·e à la disparition de son œuvre.
Des situations en apparence simples.
Des échanges qui s’enroulent, s’approfondissent, dérapent.
Et, toujours, cette question en filigrane : que fait-on de sa vie quand on commence à la penser ?
Pourquoi cette pièce fonctionne sur scène ?
Cette pièce convient tant aux compagnies amateures qu’aux compagnies professionnelles parce qu’elle est un couteau suisse de plateau :
- Format “5 dialogues” : vous jouez tout pour une vraie soirée, ou vous piochez 1 à 3 dialogues pour un spectacle court / une première partie / un festival.
- Mécaniques d’escalade très lisibles : on part d’un échange “normal”, puis la logique s’emballe (comité de lecture hystérique, thérapie-cathédrale de souffrance, salle des profs qui craque, éditeur en mode gestion de crise).
- Jeu d’acteur gourmand : c’est du ping-pong, de l’ironie, du sérieux poussé jusqu’au ridicule. Ça demande du rythme. Et ça paye.
- Distribution modulable intelligemment : les rôles “Un / Deux / Trois / Quatre” permettent soit un duo qui tient la soirée, soit une rotation (jusqu’à 12 comédiens si vous changez de binôme à chaque dialogue).
- Variété de couleurs sans changer de monde : meta-théâtre, absurdité philosophique, satire sociale, comédie de profs, farce noire éditoriale… Le public reste en haleine.
Distribution et jouabilité
Distribution
- Nombre de personnages : variable (selon les dialogues choisis)
- Échelle de distribution : 2 → 12 comédiens
- Adaptations possibles : oui (genre, répartition, montage)
Durée
- Durée standard : 70 à 90 min (intégrale)
- Variantes possibles : oui (dialogues jouables séparément)
Représenter la pièce (SACD)
Toute représentation publique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la SACD.
Autres distributions possibles
Vous cherchez une pièce jouable avec une autre distribution ?
→ Voir toutes les comédies par nombre de comédiens
Conseils de mise en scène
Pistes de travail
Rythme et tempo
Ne pas craindre les silences. Le texte respire. Le rire naît souvent après la pensée.
Gestion des espaces
Un même dispositif peut suffire pour l’ensemble de la pièce. Changer l’axe, la distance, la posture.
Équilibre du jeu
Jouer sobre. Plus l’interprétation est ténue, plus l’absurde surgit avec force.
Ils·Elles ont monté cette pièce
🎭 la Compagnie Tableau Blanc, à Anderlecht, Belgique en juin 2021
🎭 l’Atelier Théâtre de l’Institut Notre-Dame, à Beaurain, Belgique, en mars 2024.
Vous aimerez aussi
Pièces de distribution similaire
- Sketchs à gogo (si vous aimez les formats plus éclatés et plus courts)
- Les 7 péchés capitaux (si vous souhaitez une satire plus thématique)
- Collision (si vous aimez les duels verbaux tendus)
Questions fréquentes sur Dialogues vagabonds
Pourquoi ça s’appelle Dialogues vagabonds ?
Parce qu’aucune conversation ne sait vraiment où elle va. Les personnages marchent, trébuchent, digressent — et finissent toujours par se retrouver où ils ne l’avaient pas prévu.
Est-ce que ce sont des sketchs ou des scènes de théâtre ?
En réalité, ni tout à fait l’un, ni tout à fait l’autre : ce sont des bulles de parole où le comique naît du sérieux, et le sérieux du comique. On commence par rire… puis on se demande de quoi.
Est-ce que c’est facile à jouer ?
Oui, à condition d’aimer se perdre. Ces dialogues demandent du rythme, de la précision et une vraie écoute. Les acteurs ont le temps d’exister, de respirer, d’aller au bout d’une idée folle.
C’est plutôt pour quel type de public ?
Pour ceux qui aiment l’absurde sans les grimaces, la parole sans le bavardage, et les situations où rien ne se passe… mais tout se joue. Si votre public aime Ionesco, Queneau ou Devos, il se sentira chez lui.
Porte ouverte
Vous avez une compagnie ?
Si vous vous demandez si cette pièce est jouable avec votre distribution
ou si un montage spécifique est envisageable,
👉 nous écrire
Ne manquez pas nos autres textes comiques
Voir d’autres comédies pour 5 personnages
Voir d’autres comédies pour 4 personnages
Voir d’autres comédies pour 8 personnages
Voir d’autres comédies pour 6 personnages
Recevoir une comédie chaque mois ? Conseils de mise en scène, sélections de pièces, coulisses d’écriture