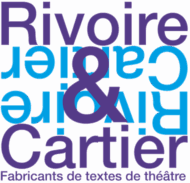Créer du lien avec les collectivités locales est bien plus qu’un enjeu logistique ou financier : c’est une démarche stratégique qui peut garantir l’ancrage et le développement durable d’une compagnie de théâtre amateur. Encore faut-il savoir comment les aborder, les convaincre… et les fidéliser.
1. Qu’est-ce que les collectivités locales ?
En France, les collectivités locales — ou collectivités territoriales — regroupent plusieurs niveaux d’administration décentralisée : la commune, le département et la région. Ces entités disposent de compétences propres, notamment en matière culturelle, sociale, éducative et économique.
Elles sont les interlocutrices naturelles de toute structure artistique de proximité. Pour une compagnie de théâtre amateur, elles représentent souvent les premiers partenaires institutionnels : ceux qui prêtent une salle, subventionnent un projet, aident à la communication, ou simplement ouvrent leurs portes pour accueillir une représentation.
2. Pourquoi entretenir de bonnes relations avec elles lorsqu’on est une compagnie de théâtre amateur ?
Nous le savons d’expérience : sans relations de confiance avec les élus et les services culturels locaux, un projet, aussi enthousiasmant soit-il, peut vite se heurter à des freins.
Entretenir de bonnes relations avec les collectivités locales permet notamment de :
- Bénéficier de ressources matérielles : lieux de répétition, salles de spectacle, matériels techniques.
- Obtenir un soutien financier : subventions de fonctionnement, aides au projet ou au rayonnement.
- Accroître sa légitimité : une compagnie soutenue localement gagne en crédibilité auprès d’autres partenaires.
- Inscrire son projet dans la vie du territoire : ce qui augmente la visibilité et la reconnaissance de la compagnie.
- Construire un réseau d’acteurs culturels : en participant à la dynamique associative et culturelle locale.
Nous l’avons souvent entendu dans les coulisses de réunions municipales : « On soutient ceux qui sont présents, qui s’investissent et qui créent du lien. » C’est donc bien sur le terrain que tout commence et sur la bonne et juste compréhension de la collectivité dont votre compagnie est l’interlocutrice. Afin de bien débuter la relation, l’outil du « plan de découverte » peut être utile ?
3. Qu’est-ce que le plan de découverte ?
Le plan de découverte est une phase essentielle dans toute démarche d’entrée en relation, notamment dans une relation institutionnelle. Il s’agit d’un entretien structuré, durant lequel nous cherchons à comprendre en profondeur notre interlocuteur avant de formuler une proposition.
Loin d’un simple échange de courtoisie, le plan de découverte repose sur un questionnement méthodique, centré sur trois grands axes :
- Le contexte : Quel est l’environnement dans lequel évolue la collectivité ? Quels sont ses projets, ses contraintes, ses objectifs politiques et culturels ?
- Les besoins exprimés : Que recherche-t-elle en matière d’offre culturelle ? Quels types de publics souhaite-t-elle toucher ? Sur quels territoires souhaite-t-elle intervenir ?
- Les freins potentiels : Quels obstacles pourrait-elle rencontrer ? Quelles limites budgétaires ou logistiques sont à prendre en compte ? Quels partenaires ou concurrents sont déjà en lien avec elle ?
En résumé, le plan de découverte consiste à écouter plus qu’à parler, en posant des questions ouvertes, précises et bienveillantes. Il permet de bâtir une relation de confiance en montrant à la collectivité que nous nous intéressons sincèrement à ses priorités. Ce plan de découverte pourra être mis en oeuvre lors d’un entretien de prise de contact ou de suivi avec la collectivité en question.
« Plus on connaît son interlocuteur, plus on construit une proposition qui répond à ses besoins réels – et pas à ce que l’on imagine être ses besoins. »
4. Comment s’en servir pour cerner les attentes de la collectivité locale ?
Le plan de découverte est un outil d’écoute stratégique. Dans le cadre d’un entretien avec une collectivité locale, il nous permet de transformer une prise de contact en un diagnostic partagé. Voici comment l’utiliser efficacement :
a) Préparer l’entretien en amont
Avant toute rencontre, il est essentiel de se renseigner sur la collectivité :
- Quelles sont ses compétences culturelles ? (via le site de la mairie, les comptes rendus de conseil municipal…)
- Quelles sont ses politiques publiques prioritaires ? (jeunesse, inclusion, ruralité, transition écologique…)
- A-t-elle déjà soutenu des projets similaires ?
- Quels élus ou techniciens sont en charge de la culture ?
Cette préparation montre notre sérieux et nous permet de poser des questions pertinentes.
b) Poser les bonnes questions
Voici quelques exemples de questions à utiliser dans un plan de découverte :
- « Quels types de projets culturels la collectivité soutient-elle prioritairement aujourd’hui ? »
- « Y a-t-il des publics que vous cherchez à toucher davantage cette année (seniors, jeunes, familles…) ? »
- « Avez-vous des lieux ou événements où vous aimeriez intégrer une compagnie de théâtre locale ? »
- « Qu’est-ce qui compte le plus pour vous dans un partenariat culturel ? »
- « Quels freins ou difficultés avez-vous pu rencontrer dans le passé avec d’autres projets artistiques ? »
Ces questions doivent être ouvertes, formulées sans jugement, et laisser à l’interlocuteur la liberté de s’exprimer pleinement.
c) Écouter activement et reformuler
Il ne suffit pas de poser des questions : il faut écouter réellement, prendre des notes et reformuler les attentes exprimées :
« Si je comprends bien, vous recherchez des propositions qui puissent toucher à la fois les scolaires et les familles, en mobilisant peu de moyens techniques. C’est bien cela ? »
Cette reformulation permet à la collectivité de se sentir comprise — et à nous de valider notre compréhension avant de proposer quoi que ce soit.
d) Adapter notre offre à ses besoins
Une fois le plan de découverte réalisé, nous pouvons construire une offre qui :
- résonne avec les priorités locales,
- anticipe les contraintes éventuelles,
- valorise la collectivité auprès de ses habitants.
Ce n’est plus une proposition standard, mais une réponse sur mesure, plus convaincante et plus susceptible d’aboutir.
5. Comment entretenir de bonnes relations ? Exemples d’actions concrètes
Voici des pistes concrètes que nous avons éprouvées (ou que nous avons vu fonctionner dans d’autres compagnies) pour entretenir des relations solides avec les collectivités locales :
a) Participer à la vie culturelle locale
Il ne s’agit pas seulement d’être visible ponctuellement, mais de s’impliquer durablement dans l’écosystème culturel local. Cela suppose de :
- Assister aux événements municipaux : vœux du maire, commémorations, remises de prix, etc. C’est l’occasion d’échanger de manière informelle avec les élus, les techniciens et d’autres acteurs associatifs.
- S’inscrire aux forums culturels et associatifs : pour tenir un stand, rencontrer le public et d’autres structures du territoire.
- Répondre aux sollicitations de la mairie : présence à une réunion consultative, participation à une commission culture, implication dans un groupe de travail local.
👉 En montrant que nous sommes présents et investis dans la vie locale, nous faisons la preuve de notre ancrage territorial et de notre engagement citoyen.
b) Être force de proposition
Les collectivités apprécient les structures qui ne se contentent pas de demander, mais qui proposent. Cela suppose de :
- Construire des projets adaptés aux besoins locaux : par exemple, proposer des spectacles qui peuvent s’intégrer dans la Semaine bleue, les Journées du patrimoine, ou des animations estivales.
- Prendre en compte les priorités municipales : inclusion sociale, développement durable, éducation artistique… En adaptant nos actions à ces objectifs, nous devenons des partenaires stratégiques.
- Apporter des solutions concrètes et réalistes : description claire, budget, planning, logistique — tout doit être prêt à l’emploi pour faciliter la décision politique.
👉 C’est en apportant des projets pertinents et réalisables que nous passons du statut de demandeur à celui de contributeur.
c) Prendre soin de la relation
Une bonne relation ne se construit pas uniquement au moment de la demande de subvention. Elle se nourrit tout au long de l’année par de petits gestes :
- Envoyer régulièrement des nouvelles : un mail ou une lettre pour présenter nos projets à venir, nos succès passés ou un simple mot de remerciement.
- Inviter les élus et les agents aux représentations ou aux temps forts de la compagnie.
- Valoriser leur présence : en les mentionnant dans les discours, en les remerciant dans les programmes, en partageant une photo sur les réseaux sociaux avec un mot chaleureux.
👉 Une collectivité soutient plus volontiers une structure avec laquelle elle entretient une relation fluide, chaleureuse et respectueuse.
d) Valoriser leur soutien
Le soutien d’une collectivité est un signal fort. Le valoriser, c’est :
- Afficher clairement les logos des collectivités partenaires sur nos supports de communication (affiches, flyers, programmes, site web…).
- Les citer explicitement dans les remerciements lors des discours, ou dans les bilans d’activités.
- Mettre en avant leur rôle dans nos succès : « Grâce au soutien de la commune, nous avons pu proposer 8 représentations dans des lieux accessibles à tous ».
👉 Montrer que nous reconnaissons publiquement le rôle de la collectivité, c’est renforcer son envie de poursuivre la collaboration.
6. Valoriser votre compagnie : construction d’un argumentaire
a) Présenter un argumentaire structuré, clair et convaincant
Convaincre une collectivité nécessite bien plus qu’une simple demande de subvention. Il s’agit de construire un discours professionnel, qui prend en compte :
- Les enjeux spécifiques de la collectivité (valeurs, orientations politiques, projets en cours),
- Le profil de l’interlocuteur (élu, technicien, agent culturel…),
- La manière dont notre projet peut s’insérer dans une politique publique locale (jeunesse, cohésion sociale, rayonnement culturel…).
Nous devons donc adapter nos arguments à chaque contexte, et c’est là que la méthode CAPSONCASE devient un outil stratégique.
b) L’outil CAPSONCASE : présentation
CAPSONCASE est la combinaison de deux approches issues du marketing et de la négociation :
1. CAP : Caractéristique – Avantage – Preuve
- Caractéristique : Ce que nous offrons concrètement (ex. : « Notre compagnie existe depuis 12 ans »).
- Avantage : Le bénéfice pour la collectivité (ex. : « Vous travaillez avec un partenaire expérimenté, stable et structuré »).
- Preuve : Une donnée ou un fait vérifiable qui valide l’avantage (ex. : « 12 spectacles montés, bilan d’activité disponible sur demande »).
Cette première grille est utile pour rendre notre discours concret, précis, et rassurant.
2. SONCASE : comprendre les motivations de l’interlocuteur
Le second volet du CAPSONCASE est d’ordre psychologique : il permet d’adapter nos arguments aux motivations profondes de la personne que nous avons en face.
Voici le détail de chaque levier :
• Sécurité
Besoin de stabilité, de prévisibilité, d’organisation.
👉 Nous devons montrer que nous sommes une compagnie sérieuse, avec une équipe fiable, une structure juridique claire, une planification rigoureuse.
Exemple : « Notre projet est déjà cofinancé à 50 % et nous avons une équipe dédiée à la logistique. »
• Orgueil
Volonté de prestige, de reconnaissance, d’image valorisante.
👉 Montrons comment notre spectacle ou notre projet valorise la collectivité : médiatisation, retombées presse, rayonnement local.
Exemple : « Le logo de la commune figurera sur tous les supports distribués à plus de 1 000 spectateurs. »
• Nouveauté
Intérêt pour l’innovation, le changement, les idées originales.
👉 Soulignons les aspects innovants de notre proposition : formats hybrides, théâtre immersif, participation numérique…
Exemple : « Ce spectacle mêle jeu théâtral, vidéo-projection et participation du public. »
• Confort
Besoin de simplicité, d’efficacité, de non-contrainte.
👉 Insistons sur notre autonomie, notre capacité à tout organiser sans alourdir les services municipaux.
Exemple : « Nous apportons tout le matériel et gérons la billetterie nous-mêmes. »
• Argent
Préoccupation budgétaire, efficacité économique.
👉 Valorisons le bon rapport qualité/prix de notre prestation, les économies indirectes (activités gratuites pour les écoles, etc.).
Exemple : « Pour 1 000 € de soutien, la collectivité bénéficie de 5 représentations et de 2 ateliers scolaires. »
• Sympathie
Affinité humaine, engagement social, proximité.
👉 Montrons notre implication locale, notre accessibilité, nos valeurs humaines.
Exemple : « Nos comédiens sont tous bénévoles et vivent dans la commune. »
• Environnement
Sensibilité écologique, développement durable.
👉 Décrivons nos efforts en matière d’écoresponsabilité : recyclage des décors, transport mutualisé, communication sans papier.
Exemple : « Tous les éléments de décor sont réutilisables ou recyclés, et nos supports sont exclusivement numériques. »
La force de la méthode CAPSONCASE réside dans sa capacité à adapter un message à la fois rationnel et émotionnel, en s’appuyant sur des faits concrets et en répondant à des besoins profonds. Pour chaque demande de partenariat, nous devrions anticiper les leviers les plus pertinents et structurer notre discours autour d’eux.
c) Un exemple de CAPSONCASE pour une compagnie de théâtre amateur
🛡️ Sécurité
Caractéristique : Notre compagnie est structurée, déclarée, et active depuis plus de 10 ans.
Avantage : Nous représentons un partenaire fiable, stable et pérenne, capable de mener un projet à son terme.
Preuve : En dix ans, nous avons monté 12 spectacles, tous documentés dans des rapports d’activités disponibles sur demande.
➡️ Pourquoi cela fonctionne ?
Les collectivités locales, soucieuses de gérer les deniers publics avec prudence, apprécient les partenaires déjà expérimentés, transparents et bien organisés.
👑 Orgueil
Caractéristique : Notre compagnie participe régulièrement à des festivals reconnus.
Avantage : En nous soutenant, la collectivité valorise son image culturelle et montre son attachement à l’excellence artistique.
Preuve : Sélection au festival régional de théâtre amateur, avec couverture presse et retombées médiatiques.
➡️ Pourquoi cela fonctionne ?
Les élus aiment associer leur action à des projets qui brillent. Soutenir une compagnie primée renforce leur image d’ambassadeurs de la culture.
💡 Nouveauté
Caractéristique : Nous créons des formats innovants : théâtre immersif, numérique, interactif.
Avantage : Cela dynamise l’offre culturelle du territoire, attire de nouveaux publics (jeunes, curieux, connectés).
Preuve : Réalisation d’un projet pilote de théâtre en réalité augmentée, testé avec succès dans deux communes partenaires.
➡️ Pourquoi cela fonctionne ?
Les collectivités en quête de modernité ou désireuses de séduire de nouveaux publics seront sensibles à cette capacité d’innovation.
🛋️ Confort
Caractéristique : Nous assurons nous-mêmes la logistique : décors, communication, billetterie, accueil.
Avantage : La collectivité n’a pas à mobiliser de personnel ou de moyens supplémentaires.
Preuve : Dossiers techniques, fiches de sécurité, rétroplannings, bilans détaillés remis à chaque représentation.
➡️ Pourquoi cela fonctionne ?
Les collectivités apprécient les partenaires autonomes, capables de s’intégrer sans compliquer le quotidien des services municipaux.
💶 Argent
Caractéristique : Nos spectacles sont proposés à des tarifs accessibles.
Avantage : La collectivité permet aux habitants de bénéficier d’un spectacle de qualité à moindre coût.
Preuve : Billetterie moyenne à 10€, 200 spectateurs par représentation, avec un excellent taux de satisfaction.
➡️ Pourquoi cela fonctionne ?
Dans un contexte de contraintes budgétaires, la capacité à proposer une offre abordable mais ambitieuse est très valorisée.
🤝 Sympathie
Caractéristique : Notre compagnie s’implique localement (ateliers, interventions bénévoles).
Avantage : Elle renforce le tissu social, crée du lien entre générations et milieux sociaux.
Preuve : Animation de 5 ateliers gratuits par an dans les écoles, collèges ou centres sociaux du territoire.
➡️ Pourquoi cela fonctionne ?
La proximité, l’humain, l’ancrage local : autant d’éléments qui séduisent les collectivités soucieuses de cohésion sociale.
🌱 Environnement
Caractéristique : Nos décors sont recyclés, nos déplacements mutualisés, notre communication écoresponsable.
Avantage : Nos actions sont en accord avec les engagements RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) des collectivités.
Preuve : Obtention du label éco-manifestation locale en 2023.
➡️ Pourquoi cela fonctionne ?
En intégrant les préoccupations écologiques dans notre démarche artistique, nous répondons aux enjeux politiques majeurs de notre époque.
Conclusion
Entretenir de bonnes relations avec les collectivités locales est une démarche de fond, qui demande du temps, de l’écoute et de la régularité. Ce n’est pas une simple stratégie de recherche de subvention : c’est la construction d’un partenariat durable, dans lequel notre compagnie trouve sa place comme acteur culturel du territoire.
Nous avons la chance, en tant que compagnies de théâtre amateur, de pouvoir tisser du lien à la fois avec les habitants et avec les institutions. C’est cette double légitimité qu’il nous faut cultiver, avec générosité, professionnalisme et clarté.
Pour aller plus loin, lisez notre article Administrer une Compagnie de Théâtre.
Afin de mettre votre compagnie sur de bons rails, nous vous conseillons la lecture de nos articles sur la meilleure manière de recruter, la rédaction des statuts de votre compagnie, la gestion du projet théâtral et la mémoire de vos spectacles.
Cet article vous a plu ? Pour ne rater aucune publication, inscrivez-vous sur le site et abonnez-vous à notre Lettre de Nouvelles.