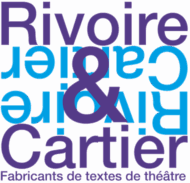Ne fait-on du théâtre qu’au théâtre ? Le théâtre ne serait-il pas plus que du théâtre ? Ne serait-il pas au fond le principe même de la vie collective de l’Être humain ?
Théâtrocratie : le point de vue d’ Evreinov
En effet, le spectaculaire ne semble pas réservé aux pratiques artistiques codées telles que le théâtre, le cinéma, la danse ou la performance. Désireux de saisir les tenants et les aboutissants du geste théâtral, Nicolas Evreinov n’envisage pas la théâtralité comme l’essence du théâtre. Au contraire, il considère cette notion en-dehors de toute référence à l’art théâtral et il affirme : « Le théâtre tel que je le conçois est infiniment plus vaste que la scène. » En réalité, la théâtralité est d’abord pour lui une des pulsions vitales de l’Homme, un instinct qui existe avant toute manifestation artistique :
L’homme possède un instinct sur lequel, en dépit de son inépuisable vitalité, ni les historiens, ni les psychologues, ni les esthéticiens, n’ont jamais, jusqu’ici, dit le moindre mot. J’entends l’instinct de transfiguration, l’instinct d’opposer aux images reçues du dehors des images arbitraires créées du dedans, l’instinct de transmuer les apparences offertes par la nature en quelque chose d’autre – bref, un instinct dont l’essence se révèle dans ce que j’appelle la « théâtralité. »
Comme l’écrit Laure Fernandez, la théâtralité n’est donc plus « à penser à partir du théâtre mais en amont, comme une composante instinctive » de l’Homme, dont Evreinov précise la nécessité :
(…) aussitôt que l’homme commence à théâtraliser, la vie acquiert un sens nouveau : elle devient sa vie, quelque chose qu’il a créé, il la transforme en une vie différente, il en est le maître et non plus l’esclave.
Toutes les contrées du monde seraient donc soumises au même régime : celui de la théâtrocratie, puisque nous serions tous, selon Evreinov, des êtres profondément théâtraux. Si l’on suit le raisonnement d’Evreinov, le discours politique ne fait alors que répercuter en son sein les processus spectaculaires que l’Homme est porté à instaurer pour construire son rapport à l’Autre et au Monde.
Le spectacle comme rapport politique
Mais on peut aussi envisager le phénomène de manière inverse et considérer que le spectacle est la condition même de la manière dont s’organise la vie en commun des êtres humains, à savoir la politique. Tel est le point de vue de Guy Debord. Encore faut-il préciser d’emblée qu’il confère au spectacle une acception tout à fait particulière. Pour lui, « Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. » L’alpha et l’oméga de ce rapport est la séparation :
Dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde, et lui est supérieure. Le spectacle n’est que le langage commun de cette séparation. (…) Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé.
Et lorsque Debord affirme : « Le spectacle est matériellement l’expression de la séparation et de l’éloignement entre l’homme et l’homme. », c’est pour dénoncer le fait qu’une partie du monde exerce le pouvoir, mandatée par l’autre et sous ses yeux. Ainsi, dès lors que l’individu et le pouvoir sont séparés, il y a production d’un rapport politique appelé « spectacle ». La démocratie représentative, modèle politique de notre modernité, ne crée-t-elle pas effectivement, au parlement — qu’on appelle aussi la « représentation nationale » — une scène pareille à l’amphithéâtre antique sur laquelle les conflits de la Nation sont représentés sous la forme d’agôns soigneusement préparés ou stylisés, et in finecontemplés par la Nation elle-même ? Si bien que la question du lieu politique et de son rapport au spectaculaire apparaît déterminante. En effet, la plupart des bâtiments abritant aujourd’hui le pouvoir législatif reprennent la forme architecturale de l’amphithéâtre, apparue dans l’Antiquité grecque sous le nom de koilon ou koilos. Or non seulement cette forme fut employée pour construire des monuments où se traitaient les affaires publiques, mais elle convint également au théâtre ou aux spectacles nautiques :
Le théâtre grec est d’abord un ouvrage d’architecture religieuse. Le monument, cependant, fut aussi utilisé pour les assemblées populaires. Athènes se dota au Ve siècle av. J.-C. de trois édifices distincts : sur la colline des Nymphes, La Pnyx, pour des rassemblements politiques ; dans l’angle sud-ouest de l’agora, l’Héliaia, pour des rassemblements judiciaires ; dans l’acropole, le théâtre de Dionysos, pour des rassemblements religieux.
Une seule forme — prémisse de l’amphithéâtre — sert pour différents usages : religion, spectacle, justice, politique. Et si l’Odéon est pour nous l’un des théâtres nationaux de France, le dictionnaire Bailly en retrace l’évolution sémantique en Grèce antique : « Édifice public d’Athènes primitivement destiné aux exercices de chants et affecté par la suite à certains services publics (tribunal de certains juges) », puis : « assemblée du peuple, lieu de distribution de blé ». Mais l’Histoire semble bégayer puisque cette interpénétration des lieux spectaculaires et politiques continue ultérieurement. La salle de jeu de paume, au XVIIe et au XVIIIe siècles, qui est d’abord un lieu de sociabilité et de performances sportives, échappe à sa fonction première pour accueillir le spectacle des performances des acteurs (les salles sont réaménagées en théâtres). Et bientôt, cette même salle est mise au service de la politique qui y théâtralise son action : du jeu sportif, spectacle et lien social, on est ainsi passé au spectacle théâtral puis, lors de la Révolution (le fameux Serment du jeu de paume, 20 juin 1789), au spectacle de la politique donnant à voir un acte performatif engageant toute la Nation. Mais que sont, maintenant, nos spectacles politiques devenus ? Sont-ils encore dans des lieux de représentation politique, autrement dit dans les chambres, hautes ou basses, de la République ? sont-ils au moins dans leurs allées ? ou sont-ils sortis de leurs enceintes consacrées ? où sont-ils donc ? dans une boîte à images ? sur une scène ? sur le pavé ? Le spectacle de la politique est d’autant plus diffus que la rhétorique des campagnes électorales n’hésite pas à recycler les codes spectaculaires en formats de communication.
À preuve, le « stand-up », forme de one-man show comique américain, a d’abord été utilisé par Barack Obama avant que des politiques français ne s’en emparent. Le stand-up, en tant que genre spectaculaire, possède un certain nombre de règles et de conventions qui permettent aux orateurs de proposer un mode d’intervention se présentant comme alternatif à défaut de l’être vraiment. Certes, l’homme politique est debout, au milieu des autres, sur une place de village, sur un trottoir : orateur et public partagent un seul et même espace, ce qui permet de supprimer toute hiérarchie spatiale entre le représentant et les représentés et d’instaurer une proximité entre l’orateur et son auditoire. L’espace unique et partagé peut en effet apparaître comme le symbole d’un destin commun. De plus, l’homme politique s’adresse à l’homme de la rue les yeux dans les yeux, sans fiche ni papier : tout se passe dans une apparente spontanéité. Et cette parole, qui se donne à voir et à entendre comme improvisée, produit une impression d’authenticité et de sincérité. Enfin, le ton est décontracté, ce qui est censé rapprocher les auditeurs de l’orateur. Le contenu du discours doit accompagner ce mouvement. Il s’agit de faire naître une complicité voire une connivence avec son public, sans dédaigner les plaisanteries.Mais ce format, perçu comme novateur, n’est que le remake d’un vieux spectacle politique : le « discours de meeting » offert cette fois-ci dans une version de poche, et qui, de surcroît, est réélaboré par l’intermédiaire des médias audiovisuels et numériques. On ne peut que souscrire à l’affirmation de Marc Abélès lorsqu’il avance que « toute société comporte une mise en scène du politique et que la nôtre n’échappe pas à la règle. » Le cérémonial du pouvoir, sa mise en scène « pénètre » dans nos foyers par l’intermédiaire de la télévision. Chaque émission politique possède ses symboles, ses rituels et porte la marque d’une sacralisation spectaculaire et laïque. Les messages, les actions et la gestuelle sont ordonnés avec une progression empreinte de la solennité que les médias lui confèrent ; chaque circonstance est un évènement filmé, mis en scène et imagé, qui est censé correspondre à une page écrite et filmée de l’histoire de la République : la sortie du Conseil des ministres du mercredi, une élection, une passation de pouvoirs ou un duel présidentiel. Image, fiction, histoire racontée, tout doit entrer dans la boite pour donner lieu au grand spectacle que le téléspectateur regarde, et dont il est, par l’écran, séparé. Le storytelling pratiqué par les communicants élabore des scenarii faisant du politique le héros d’un récit glorifiant, narration feuilletonnesque éclatée dont le téléspectateur perçoit seulement, partie émergée de l’iceberg, des séquences spectaculaires fragmentaires que les médias montent, remontent mais démontent rarement.
Le spectacle de la vie comme simulacre ? Berkeley et Goffman
On peut se demander si de tels rapprochements entre politique et spectacle ne font pas le lit d’une réaction poujadiste laquelle, veut-on croire, expliquerait le silence assourdissant des abstentionnistes. Les articles et discours politiques qui s’appuient sur des effets de mise en scène ou de jeu de l’acteur ne donnent-ils pas une image dégradée de l’exercice du Pouvoir ? Car qu’entend-t-on ici ou là ? « La politique est devenue un spectacle, une chose déconnectée de notre réalité, quelque chose de faux, de superficiel. Il n’y a plus que des apparences. Il n’y a plus de vérité en politique ». Le « Tous pourris ! » n’est pas loin. Ce genre d’imprécations s’engluent en réalité dans la spirale d’une aporie souterraine qu’il n’est pas inutile de mettre en lumière. Ainsi, au vaillant redresseur de torts qui souhaiterait faire revenir la vérité au-dessus des apparences de la politique, on fera remarquer qu’il faudra bien, cette supposée vérité, la faire apparaître ; et si, effectivement, elle finit par apparaître, elle sera devenue, elle-même, une apparence. Et l’on poursuivra utilement la conversation en exposant quelques rudiments de philosophie empiriste. La lecture des Principes de la connaissance humaine de Berkeley, en particulier, se révèle féconde pour tenter de saisir comment le spectacle politique peut s’appréhender en posant la question de sa valeur :
La table sur laquelle j’écris, je dis qu’elle existe : c’est-à-dire je la vois, je la sens ; et si j’étais hors de mon cabinet je dirai qu’elle existe, entendant par là que si j’étais dans mon cabinet, je pourrais la percevoir ou que quelque autre intelligence la perçoit effectivement. Il y avait une odeur, c’est-à-dire, elle était sentie ; il y avait un son, c’est-à-dire il était entendu ; une couleur ou une figure, elle était perçue par la vue ou le toucher.
Concernant les objets du monde :
(…) leur esse est percipi [N.d.A. : leur être c’est d’être perçu], il n’est pas possible qu’(ils) aient quelque existence en dehors des esprits ou des choses qui les perçoivent.
Si l’on suit Berkeley on pourrait ajouter : nous parlons de la vie parce que nous l’écoutons, parce que nous la regardons, parce que le spectacle de la vie est écouté, regardé, perçu, saisi. Loin d’être superfétatoire, loin d’agiter le faux pour masquer le vrai, le spectacle de la vie semble donc être la surface par laquelle il est possible d’accéder à la profondeur du champ politique. Et peut-être, ce faisant, remettrons-nous en question ce spectacle. Mais cette critique ne peut advenir sans l’examen de ce qu’on pourrait appeler le perceptible du vécu. Après tout, le sens premier que le dictionnaire donne à spectacle n’est-il pas « Ensemble de choses ou de faits qui s’offre au regard. » ?
En 1956, Erving Goffman publie The Presentation of self in Everyday Life. Le livre est traduit en français en 1973 sous le titre La Mise en scène de la vie quotidienne. Il comporte deux tomes : La Présentation de soiet Les Relations en public. C’est le livre le plus connu de l’auteur mais aussi le plus reconnu : il lui a valu un McIver Award de l’association américaine de sociologie, tandis que l’association internationale de sociologie le classe parmi les vingt ouvrages de sociologie les plus importants du XXe siècle.
La première partie du diptyque : La Présentation de soi, pose plusieurs questions : Comment nous présentons-nous aux autres ? Comment présentons-nous notre activité aux autres ? Comment gérons-nous les impressions que nous laissons aux autres ? Pour répondre à ces questions, Goffman adopte la métaphore théâtrale : dans la vie, nous sommes tour à tour acteu·r·rice·s et public. Et souvent, nous nous prenons au jeu.
La métaphore théâtrale qu’il emploie tout au long de La Présentation de soi rejoint la notion de theatrum mundi. On peut la résumer comme suit : la vie est une scène et chacun·e d’entre nous est un pantin dont les ficelles sont tirées par le Grand Horloger. Calderón, Shakespeare, Corneille ou Rotrou y ont recours. Voyez Comme il vous plaira de Shakespeare : « Le monde entier est un théâtre, et les hommes, tous, n’y sont que des acteurs. Ils font leurs entrées et leurs sorties. Un homme, au cours de sa vie, joue plusieurs rôles. »
Ce procédé de mise en abyme ou, si l’on préfère, de théâtre dans le théâtre, donne à voir le personnage de théâtre jouant lui-même un rôle, observé par un autre personnage, lui-même observé par le public, etc. L’enchâssement de ces diverses réalités débouche sur une conception absurde du monde : tout n’est qu’apparence et illusion. Goffman ne vient pas à cette conclusion. Pour lui, le théâtre n’est qu’un moyen de comparaison, destiné à expliciter la manière dont les interactions sociales se régulent. Il n’en demeure pas moins que leur structure est semblable à celle d’un spectacle et que l’analyse de Goffman mérite des développements, que l’on pourra aborder plus tard, lors d’un autre article.
Bibliographie
Marc Abélès, Anthropologie de l’État, Paris, Payot, « Petite bibliothèque Payot », Nouvelle édition 2005.
Albert Bailly, Dictionnaire Grec-Français, rédigé avec le concours de E. Egger, Paris, Librairie Hachette, 1950, réédition 1963.
George Berkeley, Principes de la connaissance humaine, trad., présentation et notes par Dominique Berlioz, Paris, Flammarion, 1991.
Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Gallimard, « folio » n° 2788, 1992.
Nicolas Evreïnoff, Le Théâtre dans la vie, Stock, 1930.
Laure Fernandez, « La théâtralité chez Nicolas Evreinov : pour un théâtre ‘infiniment plus vaste que la scène’ », actes de la Journée des doctorants du CRHT-Paris IV-Sorbonne, 16 mai 2009. http://www.crht.paris-sorbonne.fr/matrice/wp-content/uploads/2009/10/fernandez_mep.pdf
Erwing Goffman, La Mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : La Présentation de soi. Tome 2 : Les relations en public, les éditions de Minuit, 1973.
Jean-Claude Moretti, « Morphologies des théâtres de la Grèce antique » in Histoire de l’Art n° 17/18, Dossier Architecture et Arts du spectacle, Paris, Centre National des Lettres, 1992.
D.W. Winnicott, Jeu et réalité, Gallimard, 1975.