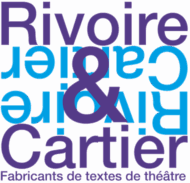Introduction : Pourquoi raconter l’histoire de la comédie ?
Pourquoi rions-nous au théâtre depuis plus de deux mille ans ?
Et surtout… pourquoi recommençons-nous, génération après génération, à fabriquer du rire, à le ciseler, à le jouer, à le transmettre — comme s’il s’agissait d’un art noble, sérieux, presque vital ?

Ces questions nous obsèdent depuis longtemps. Derrière les éclats de rire, les portes qui claquent et les valets maladroits, nous voyons une vérité bien moins légère qu’il n’y paraît : la comédie théâtrale n’a jamais été un simple divertissement. Elle peut être moqueuse, cruelle, tendre, grotesque, joyeusement bête ou subtilement corrosive — mais elle porte toujours en elle un regard sur le monde, sur les humains, sur les puissants comme sur les ridicules.
Depuis l’Antiquité grecque jusqu’à nos jours, la comédie a traversé les siècles, les langues, les régimes politiques, les censures et les modes. Elle s’est tour à tour faite satirique, populaire, codifiée, transgressive, absurde, élégante ou brutale. Elle a survécu à tout, même au mépris de ceux qui la reléguaient au rang de « genre mineur ». Rien que pour cela, elle mérite qu’on lui rende hommage.
Dans cet article, nous vous invitons à voyager dans l’histoire de la comédie théâtrale, non pas comme dans une encyclopédie poussiéreuse, mais comme dans une conversation entre passionnés. Nous vous livrons notre regard : celui d’auteurs contemporains qui écrivent des comédies, qui aiment leurs racines, leurs audaces, leurs ratés parfois… et la joie d’arriver de temps en temps à faire tenir le monde en équilibre sur un éclat de rire.
Que vous soyez metteur en scène, comédien, enseignant, ou juste curieux de théâtre, cette histoire est aussi la vôtre.
Car sans le vouloir, vous êtes les héritiers d’Aristophane, de Molière, de Feydeau, de Beckett., comme les fous que nous sommes le sont aussi.
1. Les racines de la comédie : un rire entre rituel et politique
Quand on remonte aux origines du théâtre occidental, on tombe très vite sur une surprise : le rire est là, tout de suite, dès le début. Et il est loin d’être secondaire. La comédie naît en même temps que la tragédie, dans ces célébrations dionysiaques où le vin, le chant, les masques et les satires s’entremêlaient joyeusement. Si la tragédie s’adresse aux dieux, la comédie, elle, s’adresse franchement aux hommes. Et souvent, pour leur dire leurs quatre vérités.
Chez les Grecs anciens, la comédie est une affaire sérieuse. Aristophane, avec ses Grenouilles, ses Cavaliers et ses Oiseaux, ne se contente pas de faire rire le peuple d’Athènes : il le bouscule. Il moque les puissants, caricature les philosophes, attaque les démagogues. Il fait de la scène une arène politique, où le comique devient une arme de participation civique. Ce n’est pas encore du stand-up, mais ça y ressemble furieusement.

Ce que nous retenons de cette époque, ce ne sont pas seulement les grandes figures masquées ou les chœurs grotesques. C’est l’idée que le rire peut et doit questionner l’ordre établi. Que le comique est capable de faire trébucher les dogmes. C’est aussi l’invention de grands ressorts comiques que nous utilisons encore aujourd’hui : l’exagération, la parodie, la rupture de ton, la moquerie sociale.
Puis viennent les Romains, qui reprennent à leur sauce les recettes grecques. Plaute et Térence délaissent les discours politiques pour se concentrer sur l’intrigue, la ruse, les situations cocasses. Le valet rusé, le maître idiot, le jeune premier maladroit, la servante plus fine que tout le monde : tout cela est déjà là. Le comique devient plus mécanique, plus scénarisé, plus proche de ce que nous appelons aujourd’hui la dramaturgie.
Ce théâtre latin est populaire, direct, rythmé. Il prépare le terrain pour des siècles de théâtre comique à venir. Nous lui devons la structure en actes, les quiproquos, les déguisements, les portes qui s’ouvrent et se referment au mauvais moment. Il est notre grand-père déjà efficace dans la clarté des traits de caractère qu’il met en scène, et riche en bons mots.
C’est dans cette double racine grecque et latine que la comédie puise ses deux grandes veines : la satire et la mécanique. Le regard qui dénonce, et l’horlogerie du rire. Deux dynamiques qui, depuis, n’ont cessé de se croiser, de s’opposer, de se renouveler.
2. Les avatars de la comédie au Moyen Âge : le rire reprend la rue
Avec la chute de l’Empire romain, le théâtre officiel disparaît pendant plusieurs siècles. Mais le rire, lui, ne meurt pas. Il change simplement de territoire. Il quitte les grandes scènes de pierre pour se réfugier dans les rues, les foires, les marchés, les parvis d’Église. On le retrouve dans les carnavals, dans les processions inversées, dans les textes anonymes récités à la volée. Le rire médiéval est bruyant, libre, presque indiscipliné.
C’est dans ce contexte qu’apparaît la farce, forme théâtrale courte, grinçante, jouée à la sauvette entre deux sermons ou deux mystères religieux. La farce, c’est le retour du corps. On y tape, on y rote, on y trompe. Les maris y sont battus, les juges ridiculisés, les puissants humiliés. C’est une comédie du bas, mais qui vise souvent très haut.

Nous aimons profondément cette époque-là du théâtre comique. Elle rappelle que le rire n’a pas besoin de marbre ni de rideaux rouges pour exister. Un tréteau, trois compères ou deux commères, un seau d’eau et une envie de moquer : cela suffit. Le public est là, complice. On rit ensemble d’un voisin, d’un travers humain, d’un personnage grotesque. Le théâtre redevient un jeu collectif.
Ce que la farce médiévale nous apprend, c’est que le comique peut survivre à tout. Même à l’effacement des structures, même à la méfiance religieuse, même à l’absence de reconnaissance officielle. Elle montre aussi que le rire est une manière de reprendre le pouvoir, fût-ce symboliquement. En inversant l’ordre, en imitant les maîtres, en bousculant les rôles.
Il y a dans ce théâtre une liberté presque anarchique, que nous retrouvons parfois chez les meilleurs clowns d’aujourd’hui. Un goût de l’excès, une jubilation de l’irrespect, une énergie populaire brute. C’est un théâtre pauvre, mais puissamment vivant. Et même s’il sent un peu le chou fermenté et la poussière de taverne, il continue à nous faire rire. Et réfléchir sur la manière dont l’humanité d’en bas cherche à survivre à toute force.
3. La comédie à la Renaissance : jeux de masques
Au tournant de la Renaissance, la comédie se réinvente une forme, un souffle et une ambition. Elle voyage. Elle franchit les Alpes, s’installe dans les palais, flirte avec les cours royales, mais ne perd jamais tout à fait ses origines populaires. C’est le siècle des masques, des canevas, des intrigues en cascade. C’est aussi le moment où le théâtre comique devient un art de troupe, de jeu collectif, d’instant volé à la règle.
En Italie, surgit la commedia dell’arte. C’est l’une des grandes révolutions comiques de l’histoire. Des troupes itinérantes parcourent villes et places, armées de quelques décors, de masques de cuir et d’un répertoire commun. Pas de texte écrit, mais des canevas transmis oralement, des personnages typés, et surtout un sens aigu de l’improvisation.
Arlequin, Pantalon, Colombine, Brighella : autant de figures devenues mythiques. On y joue l’amour, la ruse, l’argent, le désir, l’illusion. Les Zanni y sont maîtres du désordre. Le comique est corporel, acrobatique, rythmé, construit sur la répétition et la surprise. Ce théâtre est un carnaval permanent, mais d’une rigueur dramatique étonnante.
Ce que nous retenons de la commedia, ce n’est pas seulement son énergie. C’est sa capacité à créer des personnages immédiatement lisibles, mais toujours à double fond. C’est aussi cette façon de faire de l’acteur un auteur sur scène, un créateur vivant de comédie. L’improvisation y est une écriture en direct, un jeu avec le public, une danse de l’instant.

Pendant ce temps, ailleurs en Europe, la comédie se transforme aussi.
En Espagne, la comedia, sous la plume de Lope de Vega ou Tirso de Molina, mélange amour, honneur, honneur bafoué et déguisements. On y retrouve des ingrédients voisins à la commedia dell’arte : personnages types, structure efficace, art du retournement. Mais le ton y est souvent plus grave, plus tendu, plus baroque.
En Angleterre, la comédie élisabéthaine explose de liberté. Shakespeare mêle tous les registres : farce, satire, romance, philosophie. Ses comédies ne sont jamais seulement comiques. Elles avancent masquées, avec une ironie douce-amère, un goût du travestissement, une tendresse inquiète pour l’absurdité humaine. Le rire y est souvent un miroir trouble.

Cette époque-là, celle de la Renaissance comique, nous fascine parce qu’elle ose tout. Elle hybride les formes, traverse les frontières, fait tomber les hiérarchies entre genres. Elle invente des langues théâtrales neuves, nourries de la rue comme des palais. Elle rappelle que le rire, pour survivre, doit parfois changer de costume. Ou de masque.
4. Rire à l’Âge classique : une comédie sous contrôle ?
Avec le XVIIe siècle, la comédie entre dans une ère de régulation. Finie l’improvisation débridée, les coups de bâton et les masques en cuir. Le théâtre devient un art noble, surveillé, mesuré, soumis aux règles de la bienséance et de la vraisemblance par un pouvoir royal qui veut régner de manière absolue, y compris sur les arts. Et pourtant, c’est dans ce cadre contraint qu’émerge l’un des plus grands génies comiques de l’histoire : Molière.
Ce que Molière accomplit est presque un paradoxe. Il respecte les formes de son temps, mais les habite d’une verve critique, d’un sens du rythme et d’une intelligence dramatique qui en font un maître du rire. Il invente des figures devenues proverbiales : le faux dévot, le misanthrope raide, le malade obsédé de sa santé, le bourgeois épris de noblesse. À travers eux, il déploie une comédie de mœurs et de caractères, où le rire grince, pique, parfois blesse.
Nous aimons justement Molière pour cela : parce qu’il ne flatte pas. Son rire n’est pas réconciliateur, il est révélateur. Il met à nu les travers humains, les hypocrisies, les ridicules sociaux. Il y a dans sa comédie une cruauté raffinée, un plaisir presque chirurgical à démasquer les prétentions et les aveuglements.

Mais Molière n’est pas seul. Corneille, par exemple, livre un répertoire comique à redécouvrir, qui préfigure Marivaux et même Éric Rohmer. Le théâtre devient un champ de bataille esthétique. La comédie, face à la tragédie, doit se justifier. Elle est tolérée, parfois admirée, mais toujours suspecte d’être trop légère, trop populaire, trop joyeuse.
Ce que cette époque nous apprend, c’est que le rire peut s’épanouir même sous la contrainte. Qu’il peut se raffiner, se concentrer, se codifier sans perdre sa puissance. Le classicisme, loin d’étouffer la comédie, l’oblige à inventer une langue nouvelle : celle de la précision, du rythme, de la réplique cinglante. C’est un théâtre d’horloger, où chaque mot est pesé.
Et surtout, c’est un théâtre qui continue à parler. Les comédies du XVIIe siècle n’ont pas seulement traversé le temps parce qu’elles sont bien écrites. Elles ont survécu parce qu’elles tapent juste. Parce qu’elles touchent à quelque chose d’universel dans le rapport au pouvoir, au désir, à l’orgueil, à la peur du ridicule.
Ce rire-là, tendu, élégant, impitoyable, nous inspire encore. Il nous rappelle qu’on peut faire rire sans jamais renoncer à penser.
5. Rire au XVIIIe siècle : comédie, société et (r)évolutions
Le XVIIIe siècle poursuit la lente métamorphose de la comédie. Moins bruyante, moins farcesque, elle devient plus subtile, plus psychologique, plus sociétale. Elle abandonne peu à peu les valets frappeurs et les maris trompés pour explorer des personnages plus nuancés, des conflits plus intimes, des tensions sociales plus assumées.
C’est le siècle des salons, des Lumières, des idéaux naissants d’égalité et d’émancipation. Et la comédie n’est pas en reste. Elle devient un outil d’observation du monde bourgeois, un théâtre d’analyse sociale. Elle s’interroge : que veut dire aimer ? mentir ? obéir ? trahir ? Comment se négocient les places dans une société en mutation ?
Beaumarchais pousse cette logique à son paroxysme. Son Figaro, héritier rusé de Scapin, devient un personnage à la fois comique, politique et visionnaire. Il dénonce les privilèges, tourne en dérision les aristocrates, annonce les bouleversements à venir. Le Mariage de Figaro n’est pas seulement drôle : il est dangereux. La Révolution gronde déjà dans les rires du parterre.

À côté de lui, Marivaux joue une autre carte : celle de la subtilité sentimentale, du langage comme outil de travestissement. Il invente des intrigues où le vrai et le faux s’emmêlent, où le désir se dit à demi-mots, où le comique naît de la finesse du jeu. Ce théâtre-là ne fait pas toujours éclater de rire, mais il fait sourire de reconnaissance. Il touche à la mécanique des cœurs.
Et puis il y a Diderot, avec son théâtre « sérieux », entre drame et comédie. Une tentative de sortir du manichéisme des genres comiques et tragiques, pour proposer une forme mixte, plus proche de la vie. Un théâtre moral sans moralisme, qui prépare les formes du siècle suivant.
Nous voyons dans ce XVIIIe siècle un moment charnière : la comédie cesse d’être une simple distraction pour devenir un outil de pensée. Elle commence à parler de justice, de condition sociale, de conflit entre générations. Elle se rapproche de la réalité, sans pour autant renoncer au jeu. Elle devient plus ambitieuse, plus politique, parfois plus douce aussi.
Et cette ambivalence nous touche. Parce qu’elle annonce une comédie moderne, toujours en tension entre le rire et le réel. Une comédie qui cherche à divertir, mais aussi à éveiller.
6. La comédie du XIXe au XXe siècle : la prolifération des formes comiques
Au XIXe siècle, la comédie n’a plus un seul visage. Elle se multiplie, se spécialise, se fragmente. Elle devient tantôt une machine à faire rire, tantôt un miroir social. Elle s’installe dans les grandes villes, dans les théâtres bourgeois, dans les cafés-concerts, dans les scènes dites « de boulevard ». Et elle connaît un succès populaire immense.
Le vaudeville, genre roi de cette époque, est à la fois un héritier et une mutation. Héritier de la comédie de situation, du quiproquo, du comique d’intrigue. Mutation par sa vitesse, sa précision, son efficacité redoutable. On y entre par erreur dans la mauvaise chambre, on y dissimule une maîtresse dans un placard, on y feint, on y fuit, on y trébuche. Scribe et Labiche s’y illustrent avec brio.

Feydeau en est le maître absolu. Ses pièces sont des mécanismes d’horlogerie. Tout est agencement, tempo, renversement. Il transforme le mensonge en art de scène, le délire en logique. Ce théâtre-là n’a pas pour but de faire réfléchir longuement, mais de faire rire immédiatement, et fort. Et cela n’a rien d’indigne. Car sous la légèreté apparente, perce souvent une cruauté sociale : les petits travers deviennent des monstres, les lâchetés banales des catastrophes.
Courteline, quant à lui, pousse le comique vers une absurdité administrative grinçante. C’est le règne des petites humiliations, des règlements absurdes, de la bureaucratie étouffante. Le rire devient plus sec, plus noir.
Puis vient le XXe siècle. Et avec lui, un monde qui vacille. Deux Guerres Mondiales, des crises, des bouleversements sociaux et idéologiques. La comédie ne peut plus faire semblant. Elle change radicalement de ton. Elle interroge sa propre légitimité. Elle se demande : peut-on encore rire ?
C’est dans ce contexte que naît la comédie absurde. Beckett, Ionesco, Adamov. Ce n’est plus le comique de situation, ni même celui de caractère. C’est un rire de vertige. Un rire face au vide. Les personnages parlent mais ne se comprennent pas. Ils attendent, répètent, bégayent. Rien n’avance. Et c’est précisément cela qui fait rire, ou grincer.
Ce théâtre-là, révèle l’absurde fondamental de nos existences, nos routines, nos certitudes. Il abandonne les ficelles pour ne garder que l’écho du rire.

Parallèlement, d’autres formes apparaissent : théâtre satirique, comédie sociale, théâtre engagé. La comédie se mêle à l’histoire, à la psychanalyse, à l’économie. Elle devient un instrument d’analyse, un espace de résistance, une forme hybride.
Ce que nous retenons de cette période, c’est la richesse des voies explorées. Il n’y a plus une comédie, mais des comédies. Certaines héritent du boulevard, d’autres de l’avant-garde. Certaines font rire aux larmes, d’autres provoquent un malaise fécond. Toutes, à leur manière, continuent de chercher ce que le rire peut encore produire de vivant.
7. La comédie aujourd’hui : un rire pluriel, inquiet, hybride
Et maintenant ? Où en est la comédie théâtrale au XXIe siècle ? La réponse est aussi floue que stimulante. Car si la comédie a toujours su évoluer, elle semble aujourd’hui éclatée en une multitude de formes, de registres, de postures. Elle n’obéit plus à un modèle dominant. Elle s’éparpille, elle se réinvente, parfois elle s’excuse, parfois elle mord.
D’abord, il y a les héritages. Le théâtre de boulevard continue d’exister, avec ses ficelles éprouvées, ses personnages stéréotypés, ses enchaînements bien huilés. Mais il cohabite désormais avec des formes bien plus mouvantes : solos burlesques, comédies documentaires, stand-up théâtralisé, cabarets politiques, écritures collectives. La scène comique est devenue un champ d’expérimentation, un laboratoire instable. Marius von Mayenburg ou encore Ivan Viripaev en témoignent, en proposant un regard distancé et ironique sur nos réalités contemporaines.

Nous voyons aussi poindre un comique inquiet, fragile, souvent traversé par la conscience de ses propres limites. Peut-on encore rire de tout ? Doit-on faire rire à tout prix ? Faut-il s’engager ou se dégager ? La comédie contemporaine n’a plus les certitudes d’autrefois. Elle avance en boitant, mais avec lucidité. Elle sait que le rire peut blesser, mais aussi guérir. Elle le manipule avec prudence, parfois avec audace.
Ce qui frappe aujourd’hui, c’est le mélange des genres. La comédie flirte avec le drame, avec la poésie, avec le témoignage. Elle devient noire, politique, chorale, intime. Elle ne cherche plus forcément l’éclat de rire, mais le sourire en coin, le rire en suspens. C’est un théâtre de frottement, pas toujours de soulagement.
Dans le milieu amateur comme sur les scènes professionnelles, nous voyons des comédies qui osent parler de solitude, de burn-out, de vieillesse, de mémoire, d’écologie, de violence, de peur. Mais toujours avec ce décalage, ce pas de côté qui permet au spectateur de respirer, d’oser entendre.
Et puis il y a les formes émergentes : performances comiques minimalistes, théâtre immersif avec comédiens clownesques, monologues en mode fausse conférence, pastiches de TED Talks, détournements de formats télévisés. Le théâtre comique emprunte à tous les codes disponibles. Il ne respecte plus rien — et c’est souvent ce qui le sauve.
Nous croyons que cette pluralité est une chance. Le rire d’aujourd’hui n’a plus besoin d’un masque unique. Il peut être absurde, politique, trivial, poétique. Il peut être collectif ou solitaire, ricanement ou éclat. Mais tant qu’il continue à secouer quelque chose en nous, même un peu, la comédie reste vivante.
Elle n’a peut-être jamais été aussi libre. Ou aussi en danger. Ce qui est sûr, c’est qu’elle est toujours là.
Conclusion : la comédie ne meurt jamais
Traverser l’histoire de la comédie, c’est constater une chose simple : elle ne tient jamais en place. Elle change de forme, de visage, de cible, de vocabulaire. Elle survit à tout. Aux censures, aux dogmes, aux guerres, aux snobs, aux réformes ministérielles. Elle se faufile, elle se transforme, elle feint de n’être qu’un jeu alors qu’elle dit souvent l’essentiel.
Du masque d’Aristophane aux silences de Beckett, des coups de bâton des farces médiévales aux mots feutrés de Marivaux, du vaudeville aux cabarets post-dramatiques, le théâtre comique n’a cessé d’inventer des manières de faire rire pour penser. Ou de penser en riant.
Nous aimons cette idée : la comédie n’est pas un sous-genre. C’est un langage à part entière. Un regard. Une manière d’habiter le monde. Elle peut tout dire, à condition de le dire de biais, avec malice, avec amour, parfois avec férocité. Elle est à la fois un art populaire et un instrument de précision. Elle est à la fois immédiate et retorse.
Écrire des comédies aujourd’hui, c’est s’inscrire dans cette histoire-là. C’est dialoguer avec des siècles de théâtre, avec des générations de personnages, avec des milliers de rires éphémères. C’est prolonger une tradition en la trahissant un peu, comme il se doit.
Alors si vous êtes metteur en scène, comédien·ne, enseignant·e, curieu·x·se, amateur·e passionné·e ou professionnel·le aguerri·e, cette histoire vous appartient. Et si elle vous inspire l’envie de monter, de lire, de rire, de faire rire à votre tour, tant mieux.
Et maintenant ?
Si cette histoire de la comédie vous a parlé, il est peut-être temps de passer à la scène.
Sur notre site, nous mettons à disposition des comédies contemporaines à jouer, écrites avec ce même esprit : jouer avec les codes, rire avec exigence, faire vivre un théâtre accessible, drôle et intelligent.
Les textes sont en lecture libre, disponibles au format PDF, pensés pour les compagnies amateures comme pour les troupes professionnelles.
Découvrez-les ici :
Pour aller plus loin, vous pouvez aussi lire les articles suivants :
- Nos comédies policières
- Rivoire & Cartier : auteurs de comédies
- Ironie et satire dans nos textes
- Une pièce de théâtre comique ? C’est notre genre !
- Comique de situation dans notre répertoire
- La comédie policière : un genre à découvrir
Cet article vous a plu ? Pour ne rater aucune publication, inscrivez-vous sur le site et abonnez-vous à notre Lettre de Nouvelles.