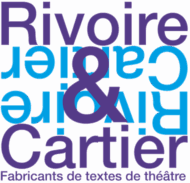Un texte de théâtre est un objet littéraire bien particulier : contrairement au roman, il ne comporte ni narrateur omniscient ni longues descriptions. L’auteur s’y exprime uniquement à travers les paroles de ses personnages et ne peut en principe commenter l’action directement. Destiné à être joué sur scène, le texte dramatique est avant tout constitué de dialogues (échanges de répliques entre personnages), qui font progresser l’histoire et révèlent les protagonistes. Autour de ces échanges s’articule une intrigue – le fil rouge de l’action – découpée de manière structurée en scènes, en actes ou en tableaux. Avant de détailler ces composantes, intéressons-nous brièvement à l’évolution historique de la forme théâtrale, de l’Antiquité à nos jours.
Les origines du texte théâtral : bref aperçu historique
Les premières œuvres dramatiques de l’Antiquité posent les bases du texte de théâtre, mais sous des formes différentes de celles que nous connaissons. Le théâtre grec ancien ignorait la division en actes : les tragédies et comédies grecques étaient jouées d’un seul tenant, sans entractes, bien qu’on puisse y distinguer diverses phases (prologue, entrée du chœur, plusieurs épisodes, sortie du chœur). C’est le théâtre romain qui institutionnalise le découpage en actes. Les comédies de Plaute et Térence ou les tragédies de Sénèque attestent de cette pratique, et dès l’époque d’Horace cela devient une règle absolue : l’Art poétique d’Horace prescrit qu’« votre fable entière, en cinq temps partagée, ne se montre jamais plus ou moins prolongée ». Autrement dit, la tradition classique impose la structure en cinq actes, considérée comme idéale.
Au XVIIe siècle, le théâtre français classique reprend cette norme : une tragédie comporte généralement cinq actes, tandis que la comédie en compte plutôt trois. Molière lui-même, pour donner plus de poids à certaines de ses comédies dites « sérieuses », les a écrites en cinq actes plutôt qu’en trois. Durant cette période, chaque acte a une fonction précise dans la progression de l’intrigue, conformément aux règles dramaturgiques héritées de l’Antiquité. S’ajoutent à cela les célèbres trois unités (unité de temps, de lieu et d’action) et les règles de bienséance et de vraisemblance, qui encadrent strictement l’écriture théâtrale classique. Notons également que les conditions de représentation à l’époque classique contribuèrent à maintenir cette division en actes. En effet, l’éclairage de la représentation est alors réalisé grâce à des chandelles, dont la durée de vie est d’environ 30 minutes. Passé ce délai, il faut les changer, ce qui impose une « pause » manifestée par le passage d’un acte à l’autre.
À partir du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, les auteurs s’affranchissent de plus en plus de ces codes. Le schéma en cinq actes laisse place à davantage de liberté : certaines pièces romantiques ou modernes se construisent en trois actes (voire en deux, comme de nombreuses comédies contemporaines, ou en un seul acte unique). D’autres pièces modernes privilégient une suite de tableaux ou de courtes scènes, sans s’imposer un nombre d’actes fixe. En somme, le texte théâtral a évolué vers une plus grande flexibilité formelle. Néanmoins, la structure classique continue d’influencer les dramaturges d’aujourd’hui et l’on retrouve presque toujours l’idée d’un début, d’un milieu et d’une fin articulés autour d’un conflit dramatique. Voyons à présent en détail les composantes essentielles du texte de théâtre : le dialogue, l’intrigue, les actes et les scènes.
Le dialogue dans une pièce de théâtre : rôle et fonction
Le dialogue théâtral – cet échange de paroles entre les personnages – est le cœur vivant du texte de théâtre. C’est grâce au dialogue que l’intrigue avance et que les personnages se révèlent ou se masquent au public. En effet, toutes les informations sur l’histoire passent par ce que les personnages se disent (ou par ce qu’ils taisent…), éventuellement accompagné de quelques indications scéniques (didascalies). Un texte dramatique se présente ainsi comme un long dialogue composé des répliques échangées par les protagonistes. L’auteur n’ayant pas la possibilité de décrire les pensées ou le décor en détails comme dans un roman, il doit tout faire transmettre par la parole et l’action : les caractères des personnages, leurs émotions, les éléments de l’intrigue, etc.
Cette primauté du dialogue confère au texte théâtral une dynamique particulière. La façon dont les répliques s’enchaînent donne le rythme de la pièce et le ton des relations entre personnages. Par exemple, de longues tirades pourront souligner l’importance d’un enjeu ou le lyrisme d’un personnage, tandis qu’au contraire des répliques très brèves qui fusent (ce qu’on appelle des stichomythies) traduisent souvent un échange tendu, un conflit ou une vive répartie comique. Le silence lui-même, dans un dialogue, a un sens : une pause peut créer un effet dramatique ou humoristique, montrer la gêne d’un personnage ou au contraire son obstination à ne pas répondre.
Il faut noter que le dialogue théâtral s’adresse en réalité à double destinataire. D’une part, bien sûr, chaque personnage parle à un ou plusieurs partenaires sur scène ; d’autre part, ces paroles sont entendues par le public qui en est le témoin privilégié. Ce phénomène est appelé la double énonciation : un personnage qui s’exprime vise toujours deux cibles – l’autre personnage dans la fiction, et le public dans la salle. Cela permet des jeux particuliers, comme l’aparté (une réplique qu’un personnage lance « à part », pour le public, sans que les autres personnages l’entendent). Quoi qu’il en soit, tout, ou presque, passe par le dialogue dans un texte de théâtre. C’est la matière orale du drame, celle qui va prendre vie sur scène par la voix et le jeu des acteurs.
La construction d’une pièce de théâtre
À travers le dialogue, le public ou le lectorat peut recomposer une ou plusieurs intrigues. L’intrigue désigne l’ensemble des événements et des actions qui constituent l’histoire d’une pièce de théâtre. On parle aussi d’action dramatique, c’est-à-dire la progression de la situation initiale vers une situation finale (dénouement) au gré des interactions entre personnages et des péripéties. En d’autres termes, l’intrigue est le fil conducteur qui lie les scènes entre elles et tient le spectateur en haleine : c’est le quoi et le pourquoi de la pièce (que se passe-t-il, et dans quel but ?).
Traditionnellement, l’intrigue d’une pièce classique suit un schéma en plusieurs étapes clés :
- L’exposition : c’est le début de la pièce, où l’on présente les personnages principaux, le contexte et la situation de départ.
- Le nœud : ce sont les obstacles et rebondissements qui viennent compliquer le parcours des personnages.
- Le dénouement : c’est la résolution finale de l’intrigue, à la fin de la pièce.
Ce schéma classique (exposition – conflits/péripéties – dénouement) n’est pas une cage rigide, mais on le retrouve, sous des formes diverses, dans la plupart des œuvres théâtrales. Même les pièces modernes ou contemporaines qui adoptent des structures moins conventionnelles gardent souvent cette logique de départ (situation initiale), de montée des tensions (problème et obstacles), puis de résolution (chute finale). Dans la dramaturgie classique, l’intrigue progresse à travers des actes.
La composition d’une pièce de théâtre : ses divisions
- L’acte
Un acte traditionnellement est la plus grande division d’une pièce de théâtre. On peut le comparer à un chapitre de roman, à ceci près qu’il répond à des impératifs propres à la scène. En effet, dans la tradition, la fin d’un acte est souvent marquée par une pause (baisser de rideau, entracte) qui permet au public de souffler et, historiquement, aux acteurs ou techniciens de changer le décor si nécessaire. Chaque acte constitue donc un segment important de l’action, et un changement d’acte peut aussi s’accompagner d’un changement de temps ou de lieu dans l’histoire. Autrement dit, l’acte se caractérise par une certaine unité : il couvre une étape de l’intrigue dans un cadre spatio-temporel donné, et le passage à l’acte suivant autorise une ellipse temporelle (avancer dans le temps) ou un déplacement de l’action ailleurs.
Dans le schéma classique, comme nous l’avons vu, une pièce pouvait comporter cinq actes (notamment pour la tragédie) ou trois actes (souvent pour la comédie). Cette subdivision répondait à des codes précis : par exemple, l’acte I posait l’exposition, l’acte V apportait le dénouement, et les actes intermédiaires développaient le conflit. Les actes d’une même pièce ont en principe une durée comparable entre eux, afin d’équilibrer le spectacle. Traditionnellement, on numérote les actes en chiffres romains (Acte I, Acte II, etc.) et chacun porte éventuellement un titre ou une indication (chez certains auteurs modernes).
Aujourd’hui, le nombre d’actes n’est plus figé : il dépend du choix de l’auteur et du rythme qu’il veut donner à son œuvre. Certaines formes brèves, comme le sketch ou la saynète, se passent même d’actes formels. Une autre division a fait son apparition un peu plus tard : le tableau.
- Le Tableau
Dans Entretiens sur Le Fils naturel (1757) et le Discours sur la poésie dramatique (1758), Diderot propose une réforme du drame centrée sur le visuel et la composition picturale de la scène : la pièce doit offrir au public autant de « tableaux »que l’action comporte de « moments favorables », y compris des scènes muettes (pantomimes) qui « se lisent » par l’œil autant que par la parole.
Conséquence immédiate : l’acte (grande division traditionnelle) cesse d’être l’unique repère structurant ; il devient un contenant à l’intérieur duquel l’auteur compose une suite de tableaux destinés à produire des états visuels mémorables (arrêts sur image, groupements, « tableaux pathétiques »).
Au XIXᵉ siècle, on voit apparaître le modèle « pièce à tableaux ». Le mélodrame populaire consacre la pratique. Les affiches de « drames à grand spectacle » indiquaient même le nombre et le titre des tableaux. Pourtant, l’unité la plus usuelle pour découper une pièce classique reste la scène.
- La scène
La scène, au sens structurel et classique du terme, est une subdivision à l’intérieur d’un acte. C’est l’unité dramatique de base : chaque scène correspond à un moment précis de l’action, généralement caractérisé par la présence d’un même groupe de personnages dans un même lieu. Par convention classique, on change de scène chaque fois qu’un personnage entre ou sort de l’espace de jeu. Ainsi, l’arrivée ou la sortie d’un protagoniste provoque une nouvelle situation intermédiaire : par exemple, la scène 3 de l’acte II commence au moment où un personnage supplémentaire rejoint la conversation, et elle se terminera quand un des personnages quittera la scène. Cette définition traditionnelle fait de la scène la plus petite unité du récit théâtral, intimement liée aux allées et venues des personnages.
Dans le théâtre classique, les scènes sont numérotées (scène 1, scène 2, etc. à chaque acte) et s’enchaînent chronologiquement sans ellipse au sein d’un même acte. Elles partagent le même décor jusqu’au changement d’acte ou de tableau : par exemple, si l’acte II d’une pièce se déroule dans un salon, toutes les scènes de l’acte II auront lieu dans ce salon et le temps de l’histoire s’y écoulera de façon continue. Ce n’est qu’au lever de l’acte III que l’on pourra, par exemple, retrouver les personnages plus tard ou ailleurs.
Les usages modernes, cependant, ont assoupli ces notions. De nos jours, un auteur peut choisir de segmenter sa pièce non plus par entrées/sorties de personnages, mais par tableaux ou par scènes au sens large, selon des critères plus libres (changement de lieu, saut dans le temps, etc., à l’intérieur même d’un acte). On voit ainsi des pièces contemporaines où les scènes ne suivent pas nécessairement l’ordre chronologique, ou où plusieurs courtes scènes forment une mosaïque narrative. Le vocabulaire s’y adapte : on parle de « tableau » lorsque la succession des séquences échappe aux règles classiques (par exemple, une série de scènes sans continuité temporelle directe peut être présentée comme une suite de tableaux). Malgré ces libertés, la notion de scène reste pertinente pour le lecteur, la lectrice, le metteur ou la metteuse en scène : elle correspond à un segment d’action identifiable, centré sur une interaction donnée entre personnages, avant une transition vers une autre situation. En bref, qu’est-ce qu’une scène ? C’est un morceau d’action à l’intérieur d’un acte, délimité soit par la distribution des personnages (entrée/sortie) dans la conception traditionnelle, soit par le choix artistique de l’auteur dans le théâtre plus contemporain.
Dans la tradition dramaturgique, et notamment chez Jacques Scherer, on distingue :
- des scènes principales (ou capitales) : elles portent un temps dramaturgique majeur (exposition efficace, aveu, reconnaissance, crise, dénouement, etc.) ;
- des scènes secondaires, dites de liaison (ou de transition) : elles relient ces moments forts, assurent la continuité et la vraisemblance (entrées/sorties motivées, passage d’un lieu/temps à un autre, préparation d’un coup de théâtre), sans être en elles-mêmes des sommets dramatiques.
Une écriture conçue en direction de la scène
En conclusion, le texte de théâtre se définit comme une écriture conçue pour la représentation scénique, qui s’organise autour de paroles échangées entre personnages, d’une intrigue structurée et de divisions formelles en scènes et actes. Ces composantes – dialogue, intrigue, scènes, actes – forment la charpente du texte dramatique et le distinguent des autres genres littéraires. Un tel texte n’est pas qu’une histoire racontée : c’est une partition vivante qui attend d’être incarnée par des comédiens.
Nous avons vu qu’un texte théâtral repose sur un dialogue permettant de donner vie aux personnages et aux conflits, sur une intrigue susceptible de maintenir l’intérêt du public dans un voyage passant par l’exposition, le nœud et de dénouement, ainsi qu’une structure visible articulée dans une succession scène/tableau/acte réfléchie (pour rythmer le spectacle et scander l’action). Bien sûr, au-delà de ces principes généraux, chaque dramaturge apporte sa touche et peut jouer avec les codes – mais connaître ces fondamentaux permet d’apprécier toute la richesse du théâtre, que l’on soit lecteur, acteur ou metteur en scène en herbe.
Nous-même, nous avons parfois utilisé le découpage en actes, tableaux et scènes, parfois non. Ainsi, notre comédie policière Un Ravissant Petit Village comporte 2 actes, placés de part et d’autre une révélation majeure. Ils marquent donc une articulation dramaturgique forte. L’acte I comporte 4 tableaux, chacun séparés par des ellipses temporelles. Les scènes y sont indiquées et numérotées, car, en tant que pièce appartenant au genre policier, Un Ravissant Petit Village fait la part belle aux confrontations entre les personnages. En revanche, dans David Vincent les a vus, pièce mélangeant le passé, le présent et le rêve, aucune division en acte, tableau ou scène n’intervient. Cela participe au continuum qui brouille la frontière entre les temporalités et les régimes de réalité.
Rappelons pour finir que la forme du texte théâtral est héritière d’une longue tradition, en constante évolution. Pour un éclairage complémentaire sur l’histoire du théâtre et la manière dont se sont développées les différentes formes dramatiques des origines à nos jours, vous pouvez consulter notre article dédié à ce sujet. Il ne vous reste plus qu’à parcourir ou télécharger quelques pièces de notre répertoire pour observer concrètement ces notions à l’œuvre… et, pourquoi pas, à monter sur les planches !
Pour aller plus loin
Cet article vous a plu ? Pour ne rater aucune publication, inscrivez-vous sur le site et abonnez-vous à notre Lettre de Nouvelles.