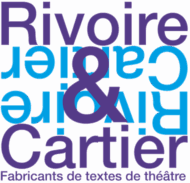Le comique de situation dans Les Fourberies de Scapin : une dramaturgie du piège
Le théâtre de Molière se livre toujours, d’une manière ou d’une autre, à une analyse des structures du pouvoir à l’intérieur des relations sociales. Les Fourberies de Scapin n’échappe pas à cette mécanique et fait du comique de situation l’outil d’une mise à nu des rapports de force entre les figures de l’autorité et celles de la ruse. Ici, le piège scénique devient le moteur même de l’action, un mécanisme structurant où la parole n’est jamais seulement un acte de communication, mais avant tout une stratégie.
1. L’escroquerie du sac : le corps captif, le langage souverain
Le théâtre est le lieu du visible, et Molière joue sur cette évidence en donnant à voir le simulacre du pouvoir. L’épisode du sac (Acte II, scène 7) illustre cette logique :
📌 Contexte : Géronte, archétype du vieillard avare, refuse de céder à la demande de son fils Léandre, qui a besoin d’argent pour sauver sa bien-aimée. Mais Scapin, agent du désordre, inverse la structure du rapport de force en simulant un danger imminent : un ravisseur imaginaire exige une rançon.
🔎 La mécanique du comique
- Le dispositif du piège : Scapin ne contraint pas Géronte physiquement, mais par la parole. Il invente un récit, fabrique une illusion qui emprisonne Géronte plus sûrement qu’une chaîne réelle.
- L’asservissement du corps : L’avare se laisse convaincre de se cacher dans un sac – geste théâtralement signifiant, où l’individu abdique toute autonomie.
- L’humiliation du maître : Scapin, simulant le rôle du bourreau, frappe le sac pour rendre l’illusion plus crédible. Le spectateur rit du renversement, du pouvoir qui change de main : l’autorité patriarcale, supposée souveraine, se retrouve dans l’espace de l’enfermement, littéralement entravée dans la matière.
👉 Le comique de situation ici fonctionne par dislocation des statuts sociaux : le maître devient objet, le valet devient maître du récit. L’espace scénique redistribue les rôles, et le public rit de cette inversion éphémère du pouvoir.
2. Le quiproquo sur l’identité de Zerbinette : le théâtre de l’aveuglement
📌 Contexte : Zerbinette, jeune femme d’esprit, raconte avec amusement comment un certain Léandre a berné son propre père pour lui soutirer de l’argent. Mais ce père trompé, Géronte, est justement celui qui écoute le récit, sans comprendre qu’il est le sujet même de la moquerie.
🔎 La mécanique du comique
- L’ironie dramatique : Le spectateur est informé du décalage, il sait ce que le personnage ignore. La scène se joue dans l’attente du moment où la vérité éclatera, produisant une jouissance anticipée.
- Le langage comme malentendu : Ici, le mot masque au lieu de révéler. Géronte entend le récit mais ne se reconnaît pas dans la figure du dupe. Le rire naît de cette erreur de perception, où le mot ne trouve pas son référent.
- Le crescendo du ridicule : Plus Zerbinette insiste sur l’ingéniosité de Léandre, plus Géronte, naïvement, participe à sa propre humiliation.
👉 Le quiproquo devient un piège linguistique : le personnage croit posséder le langage, mais en est exclu par son incapacité à décoder le réel. Molière fait ici du comique une dialectique de la révélation différée.
3. L’entrée précipitée d’Argante et l’improvisation de Scapin : la parole comme arme d’urgence
📌 Contexte : Argante, père d’Octave, découvre que son fils s’est marié en secret. Furieux, il veut l’obliger à annuler cette union. Scapin, en stratège du chaos, improvise un mensonge immédiat pour détourner la colère paternelle.
🔎 La mécanique du comique
- L’invention comme réponse au danger : Pris au piège, Scapin n’a que la parole comme protection. Il fabrique un récit fictif où Octave aurait été contraint par des brigands de se marier.
- Le retournement immédiat : La colère d’Argante se transforme instantanément en pitié, renversant la dynamique de la scène.
- L’accélération du mensonge : Scapin ajoute des détails de plus en plus extravagants, consolidant l’illusion par l’effet d’accumulation.
👉 L’efficacité du comique ici repose sur l’improvisation même du langage : plus Scapin parle, plus son récit devient absurde, et plus l’effet burlesque s’intensifie.
Le comique de situation : une dramaturgie du piège
Le comique de situation dans Les Fourberies de Scapin ne se limite pas à une mécanique du quiproquo, il repose sur une structure plus profonde : le théâtre du piège. Trois éléments majeurs définissent ce système :
- Le renversement des rapports de force : Le valet prend le pouvoir sur le maître, mais ce renversement est temporaire, générant une tension ludique.
- Le langage comme espace d’illusion : La parole, loin d’être transparente, devient un outil de domination et de dissimulation.
- L’espace théâtral comme lieu de la contrainte : Que ce soit le sac de Géronte, le discours de Zerbinette ou le piège verbal tendu à Argante, chaque scène enferme un personnage dans une illusion dont il ne peut se libérer.
Ainsi, le comique de situation chez Molière n’est pas une simple mécanique de surprise, mais une véritable mise en scène de la manipulation, où l’ordre social est momentanément suspendu pour mieux être réaffirmé.
Le comique de mots dans Le Bourgeois Gentilhomme : une sémiologie de l’illusion linguistique
Le comique chez Molière est toujours plus qu’un simple effet de surface ; il est le lieu d’un dévoilement. Dans Le Bourgeois Gentilhomme, la parole n’est pas un simple instrument de communication, elle est un objet en soi, une matière plastique que les personnages manipulent sans jamais totalement la maîtriser. C’est là que se joue le comique de mots : il naît de l’écart entre la signification attendue et la signification produite, entre ce que le langage devrait être et ce qu’il devient lorsqu’il est manipulé par un être en quête d’un statut qu’il ne possède pas.
1. Dire la prose sans le savoir : la naissance du langage bourgeois
📌 Contexte : Monsieur Jourdain, figure emblématique du bourgeois en ascension, cherche à intégrer le monde des gens de qualité. Il veut tout apprendre, tout maîtriser, y compris la rhétorique de son temps. Vient alors la révélation de son maître de philosophie : il fait de la prose depuis toujours, sans en avoir eu conscience.
🔎 Le phénomène comique
- La prise de conscience linguistique : « Par ma foi ! Il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien. » Cette déclaration fait basculer la scène dans l’absurde, non pas par son contenu, mais par l’effet de redondance entre l’énoncé et la réalité. Monsieur Jourdain découvre une évidence qui n’en est pas une.
- L’illusion de la noblesse par le langage : Il croit que le savoir est un bien que l’on acquiert, comme un costume ou une posture sociale. Mais ici, Molière montre que le langage est d’abord une pratique avant d’être un savoir conscientisé.
👉 Le comique réside dans cette méprise sémiologique : Jourdain croit atteindre la quintessence du langage, alors qu’il ne fait que le nommer. Il s’émerveille de son propre usage de la parole comme un enfant découvrirait qu’il respire.
2. Le rituel du Mamamouchi : un langage vidé de sa substance
📌 Contexte : Persuadé qu’il peut accéder à la noblesse en adoptant ses codes, Monsieur Jourdain se prête à un simulacre de cérémonie initiatique où on lui fait réciter des phrases totalement dénuées de sens.
🔎 Le phénomène comique
- La signification éclipsée par le son : « Hou la ba, ba la chou, ba la ba, ba la da ! » – cette séquence phonétique n’a aucun référent, aucun ancrage dans le réel. Pourtant, Jourdain la répète avec gravité, croyant prononcer un discours élevé.
- Le langage comme pouvoir d’assignation sociale : Molière déconstruit ici le fantasme bourgeois selon lequel la maîtrise du langage aristocratique suffirait à intégrer cette classe. Le fait que Jourdain accepte d’ânonner des mots sans sens prouve qu’il ne cherche pas à comprendre, mais à être reconnu comme appartenant à une élite.
- Un simulacre assumé : Il ne s’agit plus ici d’un simple jeu de mots, mais d’une évaporation totale de la fonction communicative du langage. Ce dernier devient pure matérialité sonore, vidé de toute substance.
👉 Le comique naît de cette inversion sémiotique : d’habitude, on parle pour signifier, ici, on parle pour être validé socialement, sans que le sens importe. L’absurde linguistique est le révélateur de l’imposture.
3. « Madame, ce m’est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d’avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m’accorder la grâce de me faire l’honneur de m’honorer de la faveur de votre présence » : le pléonasme bourgeois
📌 Contexte : Dans son ambition d’imiter le langage noble, Monsieur Jourdain accumule des tournures pompeuses, souvent maladroites.
🔎 Le phénomène comique
- Le trop-plein de langage : La juxtaposition inutile de « me faire l’honneur » et « de m’honorer » crée un excès de politesse qui se retourne contre l’intention initiale. Jourdain cherche à signifier plus, mais produit du vide.
- Une imitation qui trahit l’imposture : Là où un noble parlerait avec aisance, Jourdain se perd dans un langage laborieux, surchargé d’emphases inutiles, révélant ainsi son incapacité à adopter réellement la parole aristocratique.
👉 Le comique se situe ici dans la maladresse de l’imitation : au lieu de s’élever socialement, Jourdain dévoile son décalage par un trop-plein de langage qui devient un manque de naturel.
Le comique de mots : une rhétorique du vide
Le comique de mots dans Le Bourgeois Gentilhomme n’est pas un simple jeu linguistique, il est une mise en scène de la parole comme outil social. Il révèle trois illusions fondamentales :
- L’illusion de la découverte linguistique (Jourdain et la prose) : croire que l’on accède au savoir par le simple fait de le nommer.
- L’illusion du pouvoir par le langage (le rituel du Mamamouchi) : penser qu’en adoptant des formes langagières, on acquiert un statut.
- L’illusion de la noblesse verbale (les formules maladroites) : croire que le langage est une simple accumulation d’expressions nobles, alors qu’il est une posture, un rythme, une intériorisation des codes.
Ainsi, Molière déconstruit l’idéologie bourgeoise du langage comme sésame social : la parole ne suffit pas à donner une légitimité, elle est un révélateur des impostures. Ce que Jourdain croit être un instrument d’élévation est en réalité une mécanique d’exclusion – il parle, mais il ne parle pas bien. Il s’exprime, mais en se trahissant.
👉 Le rire chez Molière n’est jamais innocent : il est toujours l’indice d’une faille sociale, un point où l’ordre vacille, où le langage se retourne contre celui qui croit le maîtriser.
Harpagon ou la rhétorique du manque : une sémiologie de l’obsession
L’Avare de Molière est une mise en scène de la privation : l’argent, qui devrait être un instrument, devient un principe, un absolu qui structure le rapport du personnage au monde. Ce qui se joue ici n’est pas seulement le portrait d’un homme pingre, mais la théâtralisation d’un manque devenu moteur de l’existence. Harpagon ne possède pas l’argent, il est possédé par lui. Son comique de caractère ne réside pas uniquement dans une exagération du vice, mais dans une logique du vide : il ne donne pas, il ne dépense pas, il ne lâche rien. Toute sa vie est organisée autour de ce refus de la perte, qui devient en soi une mécanique dramaturgique.
1. L’avare et son propre vertige : le gouffre du moindre sou
📌 Contexte : Harpagon est un homme d’une richesse considérable, mais son rapport pathologique à l’argent transforme chaque dépense en une angoisse existentielle. Il ne vit pas, il survit au bord d’un précipice imaginaire où chaque sou s’égare dans un abîme.
🔎 La logique du comique
- Harpagon ne mesure pas la dépense réelle, mais l’inquiétude qu’elle génère. L’argent est moins une somme qu’une entité abstraite dont le moindre déplacement provoque la panique.
- Le paradoxe du possédant : Il a de l’argent, mais il ne peut l’éprouver autrement que par la peur de le perdre. Ce qui est comique, ce n’est pas l’avarice en soi, mais cette angoisse d’un homme riche qui se vit comme un indigent.
- Une rhétorique de la négation : Harpagon ne dit jamais ce qu’il a, mais ce qu’il refuse d’avoir. Son langage est fait d’évitement, de réduction, de calcul incessant.
👉 Le comique de caractère naît ici de l’exagération du manque : Harpagon n’est pas seulement avare, il est l’incarnation d’une privation fondamentale, incapable d’envisager le monde autrement que par la crainte du don.
2. La cassette ou l’objet-fétiche : une scène d’hystérie patrimoniale
📌 Contexte : La caisse d’or d’Harpagon est son véritable double. Ce n’est pas un simple trésor, mais une métonymie de son être même, un morceau de lui qui cristallise toutes ses angoisses et ses certitudes. Lorsqu’il découvre sa disparition, c’est une scène d’apoplexie théâtrale qui se joue.
🔎 La logique du comique
- Un lexique de la catastrophe absolue : « Au voleur ! À l’assassin ! On m’a coupé la gorge ! » → Le vol de la cassette est assimilé à un meurtre, preuve que son identité est réduite à cet objet.
- L’exagération comme principe comique : Harpagon déplace la gravité : ce qui serait un simple incident pour un autre devient une tragédie pour lui. Le spectateur rit de cette inflation du drame sur un élément matériel.
- Le glissement vers l’inhumanité : Il ne pleure pas un enfant perdu, un ami disparu, mais un coffre. L’attachement à l’objet remplace l’attachement humain, inversant la hiérarchie émotionnelle du réel.
👉 Le comique fonctionne ici par la transformation du vol en événement ontologique : Harpagon ne perd pas de l’argent, il perd son être. Le spectateur rit de cette confusion entre avoir et être.
3. Le banquet impossible : la grammaire du non-dépensé
📌 Contexte : Harpagon ne se contente pas d’économiser, il produit une gestion de l’impossible, où l’on doit faire tout sans rien. Son rapport à l’argent se traduit dans une logique paradoxale : il veut un banquet somptueux sans rien payer.
👉 Le comique ici repose sur une contradiction structurelle : un banquet sans argent est une négation de sa propre fonction, comme une dépense sans perte. Harpagon est donc un homme du « moins », un personnage du refus.
4. Le tyran domestique et l’échec du pouvoir absolu
📌 Contexte : Harpagon veut tout maîtriser, même ses enfants. Mais l’argent, qui lui donne une autorité matérielle, ne suffit pas à garantir son contrôle sur les désirs et les sentiments des autres.
Harpagon : un comique de la privation
Le comique de caractère dans L’Avare repose sur une obsession qui se referme sur elle-même, un personnage qui ne s’exprime que par le refus et l’impossibilité de donner. Harpagon est une grammaire du manque, où chaque interaction est marquée par une tension entre l’accumulation et la peur de perdre.
- Un comique du contraste : Il a tout, mais vit comme s’il n’avait rien.
- Un comique de l’inhumanité : Son lien aux objets est plus fort que ses liens aux hommes.
- Un comique de l’absurde : Il veut des repas sans frais, des mariages sans dot, des serviteurs sans salaire.
👉 Molière met ainsi en scène une économie du vide, où l’argent n’est plus un moyen mais une fin. Le spectateur rit de ce personnage qui, en voulant tout posséder, finit par se déposséder du réel.
Cet article vous a plu ? Pour ne rater aucune publication, inscrivez-vous sur le site et abonnez-vous à notre Lettre de Nouvelles.